Point juridique n°12 : Le Droit à la vérité
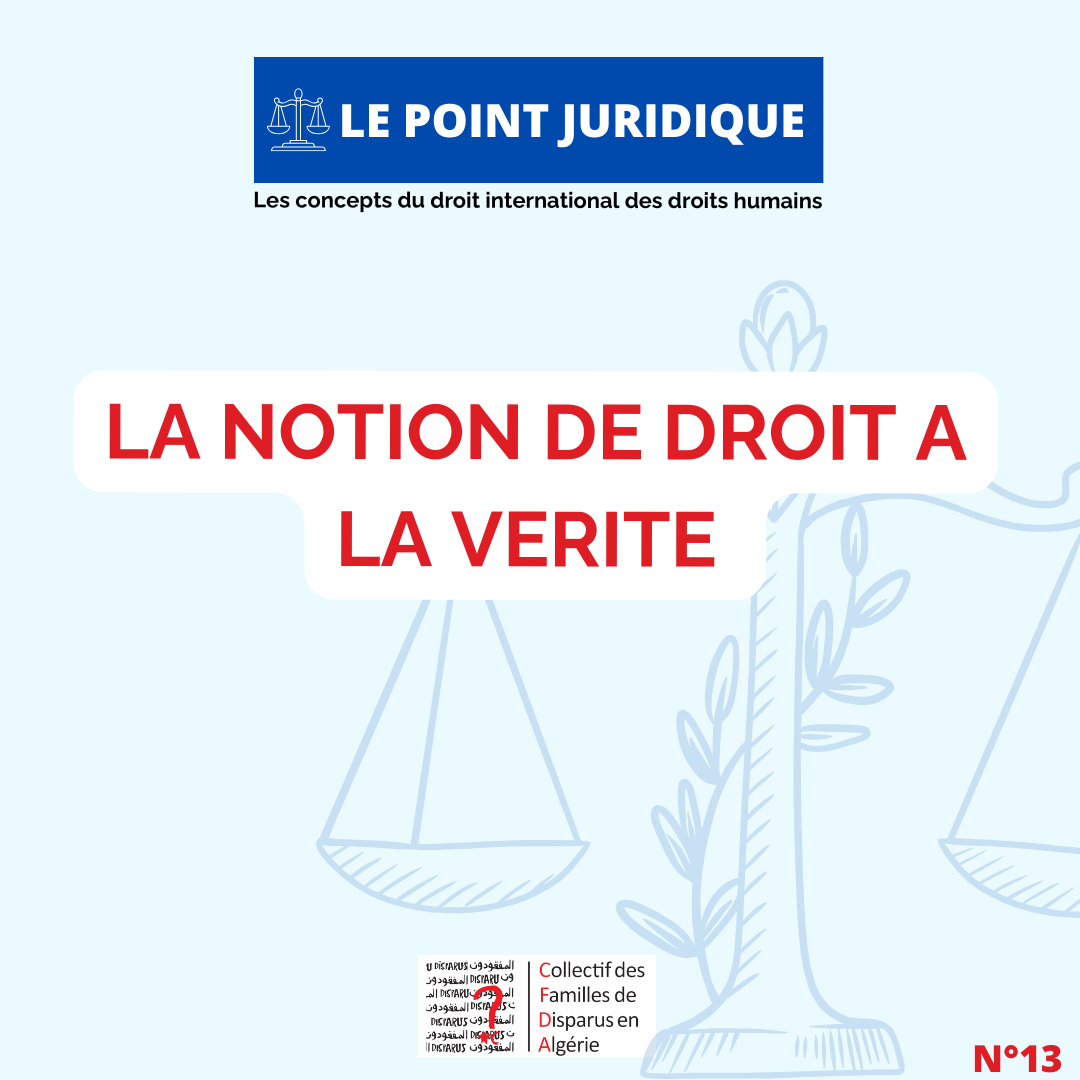
DÉFINITION
En droit international
Selon l’article 24(2) de la Convention Internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées entrée en vigueur en 2010, le droit à la vérité se définit comme « le droit de connaître la vérité absolue et complète sur les événements survenus, les circonstances spécifiques qui les ont entourés, ainsi que sur les individus impliqués, y compris les conditions dans lesquelles les violations ont été commises et les raisons qui les ont motivées ».
Ce droit est principalement invoqué dans le contexte de violations graves des droits de l’Homme, telles que les exécutions sommaires, les disparitions forcées, la torture, etc. Ces actes justifient la demande des victimes ou de leurs proches de savoir ce qui s’est réellement passé.
GENESE D’UN DROIT JEUNE
Les premières formes de revendication du droit à la vérité ont émergé dans les années 1970, notamment en Amérique latine, à travers des mouvements portés par la société civile, tels que le Mouvement des Mères de la Place de Mai en Argentine. Ce groupe de femmes a lutté pour connaître le sort réservé à leurs proches disparus sous la dictature militaire.
La reconnaissance internationale du droit à la vérité s’est progressivement construite au fil des décennies, En 1997, Louis Joinet alors rapporteur spécial de l’ONU contre l’impunité inscrit le concept de droit à la vérité dans son rapport. Par la suite, le droit à la vérité s’institutionnalise avec les statuts de la Cour pénale internationale (ONU) jusqu’à atteindre son point culminant de reconnaissance au début des années 2000.
En 2006, le Bureau du Haut-Commissaire aux droits de l’Homme a affirmé que la recherche de la vérité concernant les violations graves et flagrantes des droits humains constituait un droit inaliénable et autonome.
Ce droit est intrinsèquement lié à l’obligation de l’État de protéger les droits de l’Homme, d’entreprendre des enquêtes effectives, d’assurer des recours efficaces et de garantir des réparations.
Ce droit, impose aux États de mener des enquêtes sérieuses sur les violations, de faire la lumière sur les disparitions et d’assurer une réparation adéquate aux victimes. Ces obligations incluent des mécanismes tels que les Commissions Vérité et Réconciliation, créées pour faire toute la lumière sur les atrocités commises par des régimes répressifs ou durant des conflits armés
MECANISME D’APPLICATION DU DROIT A LA VERITE
Les diverses commissions de vérité qui on été mise en place au cours de l’Histoire avaient des mandats différents dont les missions pouvait aller de la découverte des faits survenus dans le cadre d’un conflit, à l’identification des victimes en passant parfois par la reconnaissance des responsables. L’objectif des commissions de vérité est donc de constituer un dossier historique pour éviter la réécriture du passé par des régimes autoritaires futurs ou des forces négationnistes. Ces commissions sont souvent composées de membres de la société civile, mandatés par le gouvernement et/ou des instances internationales, pour enquêter sur les violations des droits de l’Homme et contribuer à la construction d’une mémoire nationale collective et à la réconciliation nationale.
Cependant, loin d’être des solutions parfaites, ces commissions sont souvent critiquées pour leur vulnérabilité aux manipulations politiques. Les gouvernements en place peuvent les instrumentaliser à des fins partisanes.
Par exemple, la commission de vérité mise en place au Burundi, qui visait à éclaircir les massacres de 1972 dont avait été victime la communauté Hutu, a totalement occulté les massacres concomitant perpétrés contre les Tustis.
Sources :
- Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, Assemblée générale des Nations Unies, 23 décembre 2010
- Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 18 décembre 2013 sur le droit à la vérité, Assemblée générale des Nations Unies, 18 décembre 2013.
- “Droit à la Vérité”, Résolution adoptées par le Conseil des droits de l’Homme, Nations Unies, 10 octobre 2012
- Fiche thématique “Vérité et Mémoire”, International Center for Transitional Justice
- “The right to the truth in international law: fact or fiction?”, Yasmin Naqvi, International review of Red Cross
- “Les Commissions Vérité et Réconciliation, un droit à la vérité politisé?”, Université d’Aix-Marseille

